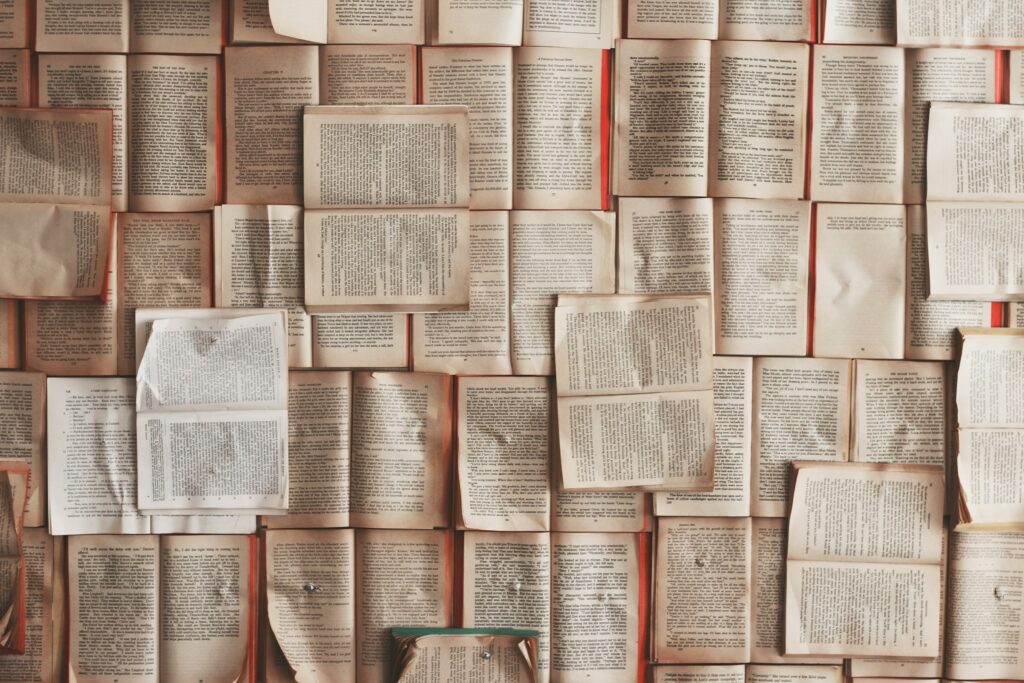« La valeur de n’importe quel terme est déterminée par ce qui l’entoure» énonce Ferdinand de Saussure dans son Cours de linguistique générale. Cette compréhension de la langue comme contexte, comme tissu, comme toile dans laquelle chaque mot est pris, laisse entrevoir la langue comme un tout. Dans ce réseau, chaque signe se réfère latéralement aux autres, desquels il tire son sens. « Ce qui entoure » les anglicismes, le tissu dans lequel ils sont insérés, c’est une langue qui leur est étrangère. C’est peut-être ici que l’on touche le fond de l’enjeu lié aux anglicismes.
S’ils n’étaient que des ajouts, à quoi bon rejeter ces formules qui enrichiraient la langue de nouvelles manières de dire ? Pourtant, que ce soit dans le vocabulaire ou la syntaxe, dans les mots ou dans leurs structures, ces emprunts gardent un caractère exogène qui les rend dissonants. Que nous utilisions des anglicismes par manque de traduction possible ou par facilité, cela nécessite de véritables appropriations, sinon trahisons, pour les insérer dans un réseau de signification qui n’était pas le leur. Ainsi, on prend le risque de s’éloigner du sens originel qu’offrait la langue anglaise et qui faisait la vigueur du terme dans son horizon. Refuser un anglicisme, ce n’est donc pas tant vouloir affirmer la langue française comme immuable et intemporelle, mais plutôt vouloir préserver la cohérence du tout qui entrelace chaque terme, et se faisant les dote de sens. Refuser un mot anglais au sein d’une langue étrangère, c’est refuser d’isoler, et non pas refuser d’intégrer. Le cœur de l’anglicisation du discours, c’est sans doute le calque de formules traduites terme à terme. Si les tours syntaxiques s’imprègnent de plus en plus de modèles de phrases à l’américaine, cette nouvelle façon de dire témoigne de l’adoption d’un mode de pensée, internalisé dans la langue. Se dessine une uniformisation subreptice. Là où nous renonçons à transposer, à adapter, à interpréter, on accepte sans questionner une expression toute faite, qui, comme telle, ne peut pas véritablement être nôtre. Au contraire, les anglicismes pourraient devenir une occasion de vivifier et d’inventer une langue enrichie d’échanges féconds avec l’anglais.
Répertorier ces anglicismes, c’est d’abord les identifier comme tels de manière à déceler le sens que ces mots ou constructions ont pris dans la langue française. Repérer les anglicismes qui se sont immiscés dans notre langue, c’est une première étape pour vivifier le sens de mots français qui peuvent en rendre un aspect, mais aussi pour redonner au mot anglais son sens originel. Il s’agit de réinventer la langue française, bien plus que de traduire ce qui a l’essence de ne pas se traduire. Troquer les anglicismes pour des expressions françaises, c’est là remotiver des expressions anciennes ou façonner de nouvelles manières de dire qui aient une teneur propre, non expropriée. Loin de représenter la restauration d’un français nostalgique ou idéal, qui n’aurait jamais rencontré l’anglais, cette réinvention permet en fait de mettre en mouvement une langue neuve. En ce sens, le but n’est pas de purifier la langue française de ses aspérités venues de langues étrangères, mais au contraire de lui offrir une vitalité. Plutôt que de substituer simplement les anglicismes à des correspondants français calqués ou arbitraires, en questionner les usages et la portée est de mise.
Les anglicismes nous poussent donc dans l’ère d’une poétique nouvelle. Entre résiliation et lutte, ils nous portent au contact de la langue, ils nous mènent à choisir activement. Si nous rejetons l’hermétisme stérile et l’acceptation passive, si nous choisissons la fécondité que nous offre la rencontre des langues, alors nous pouvons créer la nôtre. Mais pour que les langues fassent véritablement connaissance, pour qu’elles tirent profit les unes des autres, encore faut-il qu’elles conservent chacune une altérité propre. Préservons ce caractère neuf de la langue étrangère, cette aspérité colorée du mot apatride, cette différence de la formule, qui en font le charme et l’attrait. Percevoir les anglicismes permet de faire droit à leur caractère emprunté, prêté, autre. Ils vivent comme à crédit dans le français. Qu’ils soient intégrés, comme étant français de droit, ou rejetés, comme étant encore étrangers, qu’on les louent ou qu’on les blâment, qu’on les utilisent ou qu’on les refusent, ils restent de facto un élément à part entière de la langue française actuelle. Force est de les nommer, de les interpréter, de les adapter. En cela, Le Dictionnaire des anglicismes nous donne une opportunité de porter un jugement éclairé sur ces expressions, de choisir en pleine conscience de les intégrer ou de les rejeter.
En ce sens, ce dictionnaire peut permettre de renouveler à la fois notre utilisation de la langue française et notre rôle auprès d’elle. On peut le concevoir comme un outil pour continuer de la questionner et de l’enrichir. Loin d’accepter sans appel une langue venue du dehors, il s’agit d’en construire de nous-mêmes la richesse et la vivacité à mesure qu’elle évolue au contact de ses voisines.

Par Smila Thorin, étudiante et rédactrice pour La Voix au Chapitre